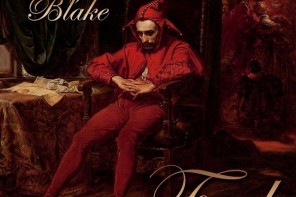C’était écrit dès le 10 janvier : David Bowie allait dominer l’année musicale 2016. D’abord, bien sûr, pour le gouffre béant aujourd’hui laissé par sa disparition. Mais aussi, chose plus surprenante, pour un ultime album forcément testamentaire. Et à regarder les Tops annuels, les couves de décembre et les coups de cœur de chacun, Bowie, tête d’affiche incontestée, ressemble à un vivant en pleine forme. Il faut croire que Blackstar, en sept titres, a convaincu la majorité ; là où l’ultime Leonard Cohen (autre grande perte 2016) est parfois cité à titre révérencieux, avec la pleine conscience que You Want It Darker n’est pas un sommet dans la carrière du Canadien.
C’était écrit dès le 10 janvier : David Bowie allait dominer l’année musicale 2016. D’abord, bien sûr, pour le gouffre béant aujourd’hui laissé par sa disparition. Mais aussi, chose plus surprenante, pour un ultime album forcément testamentaire. Et à regarder les Tops annuels, les couves de décembre et les coups de cœur de chacun, Bowie, tête d’affiche incontestée, ressemble à un vivant en pleine forme. Il faut croire que Blackstar, en sept titres, a convaincu la majorité ; là où l’ultime Leonard Cohen (autre grande perte 2016) est parfois cité à titre révérencieux, avec la pleine conscience que You Want It Darker n’est pas un sommet dans la carrière du Canadien.
Car bien au-delà des hommages posthumes et des souvenirs par milliers, Bowie est acclamé pour son ultime travail. Rare exemple où un artiste (qui plus est, une icône) réussit à faire oublier son décès pour dominer l’actualité (et les bilans annuels) avec un disque que l’on jugerait confectionné afin de battre la mort. Le titre lui-même reste sans équivoque : une étoile, même noire, par définition, ne peut s’éteindre.
En semant le mystère, en jouant sur des sonorités évolutives, en refusant le disque de folk confessionnel (et traditionnel) que beaucoup d’artistes cancéreux n’auraient guère manqué de publier, Bowie se doutait bien que Blackstar occasionnerait le débat. Ici même, en janvier dernier, l’album ne nous avait pas spécialement chamboulé l’esprit. Trop technique, hi-fi, grande musique, Blackstar laissait de marbre. Aucun mea culpa dans ces lignes : réécouté ce mois-ci, le dernier Bowie (comme si un suivant pouvait voir le jour d’ici trois saisons) ressemble toujours à un objet aux contours saillants mais à l’hermétisme souvent glacial. Pourtant, en chroniquant (trop vite) cet album inégal, nous étions passés à côté de l’essentiel : l’écrin musical de Blackstar importe moins que son contenu.
Ce fut déjà souligné, surligné, acclamé : avec Blackstar, Bowie mettait en scène sa propre mort. Il l’annonçait. Sauf que la mort, dans cet album, fréquente de très près la résurrection.
Il y a déjà l’intitulé « Lazarus » et, dans la chanson, cette phrase « Everybody knows me now ». Grand manitou de l’année écoulée (alors qu’il sommeille à présent sous d’autres cieux), Bowie affirmait son impossibilité à totalement disparaître, jusqu’à venir hanter l’écoulement des mois, jusqu’à toujours créer du débat puis finir dans les oripeaux de la personnalité la plus médiatisée de l’année. La résurrection promise fraie avec le grand capital (les inévitables inédits, best of ou démos qui pulluleront ad vitam aeternam), mais également avec le rayonnement que procure le statut de star. Et les débats qui s’ensuivirent : par exemple, Blackstar est-il un grand Bowie ? Tout en annonçant son inéluctable disparition, Bowie se savait certes éternel, mais, plus encore, il s’amusait des futurs débats en son absence.
Les films ouvertement testamentaires existent (Gens de Dublin, Sarabande, 36 vues du pic Saint-Loup) ; les disques, pas vraiment. Closer ou L.A Woman sont des œuvres testamentaires a posteriori. Il est bon de les décortiquer pour y déceler divers signes suicidaires ou dépressifs, mais cela ne dépasse jamais les spéculations du fan. Inversement, Blackstar est ouvertement pensé telle une pierre finale, the last goodbye. Que l’on aime ou pas la dernière odyssée bowienne, il faut reconnaître au Thin White Duke cet avant-gardisme lui ayant permis d’inventer un nouveaux concept après le passage de la Grande Faucheuse : rayonner parmi les vivants alors que l’artiste n’est plus. « I’m not there », disait Dylan ; « I’m everywhere », semble lui répondre Bowie.
Bizarrement, les dernières étapes du parcours bowien ressemblent au film The Hunger (Les Prédateurs, de Tony Scott, dans lequel Bowie, en 83, interprétait un vampire aristo marié à Catherine Deneuve). Dans cet ouvrage aux dorures publicitaires toujours aussi fascinantes, John Blaylock (Bowie) détenait de nombreuses existences passées (l’immortalité lui avait fait traversé les époques, de la même façon que le musicien s’était constamment réinventé en de nouvelles figures scéniques). Mais soudainement, une maladie inconnue contraignait John à vieillir en quelques jours, et à finir léthargique. Les critiques d’antan dressaient un évident parallèle avec les premiers ravages du SIDA, mais ne fallait-il pas plutôt y voir une version accélérée de la vieillesse (comme dans La Mouche, de Cronenberg) ? La vieillesse, oui… Donc la maladie… Dans le film, John ne décédait pas : il gisait entre deux limbes, dans un grenier, en compagnie des précédents amants de son épouse Miriam. Avant de ressurgir du trépas et d’énoncer le dernier mot.
Durant 2016, Bowie, pourtant mort et enterré, donnait effectivement l’impression de planer dans la pièce voisine. Ni vivant, of course, ni vraiment ad patres, aussi. Jusqu’à revenir d’entre les morts pour s’octroyer un dernier pied de nez : décédé (dit-on) mais pourtant homme de l’année, David Bowie n’a jamais semblé aussi vivant qu’aujourd’hui. Paul Muad’Dib, c’était lui.