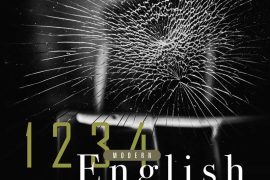Le rapport de Peter Perrett au temps a toujours été particulier. Pas étonnant pour un type qui a passé plus de la moitié de sa vie en apesanteur que les années et les secondes ne défilent pas de la même manière que pour le commun des mortels. Depuis quelques mois et la sortie de son album How The West Was Won, premier album solo en une quarantaine d’années de service et première réalisation depuis 23 ans, le temps de Peter Perrett est à la fois compté (il a désormais 65 ans et un corps diminué par les corps excès) et s’étale devant lui comme s’il n’avait jamais été aussi précieux et favorable. Le Point Ephémère est plein et il n’y a jamais eu autant de gens qui prétendent connaître intimement la carrière de son ancien groupe, The Only Ones, que ce soir. La presse papier est morte mais peut encore convaincre 300 ou 400 personnes dans la capitale de se déplacer pour honorer l’un des plus grands compositeurs rock de la fin des années 70. Télérama, les Inrocks et les autres ont fait leur travail : Peter Perrett est de retour !
Le rapport de Peter Perrett au temps a toujours été particulier. Pas étonnant pour un type qui a passé plus de la moitié de sa vie en apesanteur que les années et les secondes ne défilent pas de la même manière que pour le commun des mortels. Depuis quelques mois et la sortie de son album How The West Was Won, premier album solo en une quarantaine d’années de service et première réalisation depuis 23 ans, le temps de Peter Perrett est à la fois compté (il a désormais 65 ans et un corps diminué par les corps excès) et s’étale devant lui comme s’il n’avait jamais été aussi précieux et favorable. Le Point Ephémère est plein et il n’y a jamais eu autant de gens qui prétendent connaître intimement la carrière de son ancien groupe, The Only Ones, que ce soir. La presse papier est morte mais peut encore convaincre 300 ou 400 personnes dans la capitale de se déplacer pour honorer l’un des plus grands compositeurs rock de la fin des années 70. Télérama, les Inrocks et les autres ont fait leur travail : Peter Perrett est de retour !
Le concert est porté à bout de voix par le chanteur, entouré par ses deux fils, l’un à la guitare, l’autre à la basse, par une brillante violoniste synthétique et une jolie claviériste au déshabillé résille irrésistible. Perrett est lui-même vêtu comme un vieux punk à la John Cooper Clark : noir intégral, calotte de cheveux corbeau et veste serrée. L’homme n’a plus rien de l’ange blond des années 70. Il n’a plus non plus la fragilité avec laquelle il avait fait son retour il y a dix ans lors de la reformation de The Only Ones. Sa voix est solide et a retrouvé une grande partie de son ancienne vivacité. Le timbre est toujours aussi singulier, sardonique et nasillard, sorte de Lou Reed pincé, tranchante et parfaitement adaptée à ses textes noirs et incisifs. L’homme n’est pas grand mais dégage une classe de revenant impressionnante. Ses mots sont comptés et son dos est courbé par le fardeau d’une vie passée à s’intoxiquer. Il arbore ses éternelles lunettes noires qui lui permettent de supporter, lorsqu’il décide d’évoluer dans le monde, la vue du réel. They put the light on me, chante-t-il. They examined every part of me. On y est.
Le tempo ou la vie
Le concert est organisé très clairement autour du nouvel album, lequel est joué intégralement tout au long de l’heure et demie de concert. Peter Perrett excelle désormais dans les développements down et mid-tempo, les morceaux de bravoure, les instants confessionnels. Cela tombe bien, de ces instants au boudoir, pleins d’humour ou de nostalgie, d’attention pour les amours passées ou présentes (son épouse, Zena, éternelle compagne aux enfers et remise depuis peu d’un cancer), d’introspections sans ménagement, How The West Was Won en est plein. Cela démarre par Sweet Endeavour, Hard To Say No, An Epic Story, en ouverture entendue et qui crée le lien d’emblée. Peter construit sa légende devant nos oreilles enamourées : l’homme est un survivant, un homme qui a tout connu et qui a failli de n’avoir jamais résisté aux démons. L’homme a coulé par choix, a-t-il laissé entendre, parce que les profondeurs n’étaient pas si mauvaises et parce que le temps y passait sans ennui. Il a installé la femme qu’il aimait dans un ménage à trois (Troïka), fait couler dans ses veines l’équivalent d’une année de production narcotique mondiale mais est revenu pour faire triompher le rock (Something in My Brain). Le conte est noir et merveilleux. Tout le monde marche. La biographie que lui a consacrée Nina Antonia est plus ambiguë, mais tout le monde s’en moque. A chaque fois qu’il est apparu, Peter a montré qu’il n’avait rien perdu de son talent. Ses chansons disent son âge, sa surprise d’être encore là et son envie de profiter de l’instant… pour ce qu’il vaut. Peu importe s’il décide de retourner un jour d’où il vient. La fin du voyage n’est pas si loin. Il chante avec conviction, abrité derrière un groupe qui joue tout cela à la perfection. Jamie est un virtuose de la guitare. Il ne remplacera jamais le jeune et magnifique John Perry, tout en tension et en défi, son double d’alors, toxique mais surnageant. Jamie a l’air d’un écolier à côté mais la complicité qu’il noue avec son père sert l’émotion à merveille. Le concert de Perrett est un conte beau à se relever la nuit. Il donne le vertige. Le public est persuadé qu’il doit protéger le chanteur et lui témoigner un accueil chaleureux. Perrett sourit et fait semblant. Même les serpents brillent. Even Serpents Shine. La raison du plus fort est toujours la meilleure.
Des rats et du crack
How The West Was Won montre quel compositeur politique il a été. En rappel, War Plan Red, un morceau qui n’a pas été retenu pour l’album, est encore meilleur, punk et radical. Quel dommage que le monde n’ait pas été détruit. Perrett est plein d’audace. Il parle peu mais n’hésite pas à montrer qu’il en a encore sous le capot. Ses nouvelles compositions (Close Enough To Touch notamment, Love ‘s Inferno) sont exposées pendant le rappel où les artistes expérimentés tentent souvent de faire plaisir au public. Perrett signale par là qu’il n’a jamais cessé de croire en lui et en son futur. On y va avec lui. Les Only Ones étaient un groupe punk qui savait jouer. L’homme sait très bien qu’il a tout eu pour lui : la drogue, les femmes, les meilleures chansons. Le succès qui l’a fui n’aura jamais compté. Il est venu sur le tard justifier ce qu’il savait déjà : la beauté, la supériorité de ses talents de compositeur, la beauté de ses textes. Tout est en place depuis 1976 pour que les honneurs tombent. On les aurait aimés plus tôt mais qu’est-ce que le temps ? Qui dit que nous sommes 40 ans plus tard et pas à l’endroit précis d’où tout est parti ? Le public est rempli de vieux et de fantômes. Le Point Ephémère est une demeure victorienne, bombardée pendant la Guerre, un abri atomique, la cave d’une auberge à crack. Tout se ressemble et se désassemble.
Les meilleures chansons du nouvel album reposent sur les meilleurs textes : les rats qui choisissent le crack au lieu la nourriture (Something in My Brain), le magnifique Take Me Home qui donne des frissons à la salle entière à la fin du set principal. Les meilleures chansons de The Only Ones reposaient sur l’évidence mélodique. Le set est parsemé de fulgurances. Peter évite les morceaux uptempo qui l’épuisent. On peut étirer l’ennui et les solos comme des songes. Il joue un Another Girl, Another Planet enflammé parce qu’il n’a pas le choix. Les autres chansons venues du passé ne sont pas les plus mémorables à l’exception de The Big Sleep, chafouin comme jamais, et Baby Dont Talk. La première est toujours aussi magnifique. Woke Up Sticky, seul vestige de l’album pourtant incroyable de 1994, est l’une des meilleures pièces de toute la carrière de Peter. It’s The Truth est chantée seul sur scène en regardant la mort dans les yeux. Le temps est aboli. Cette chanson a été composée pour être chantée 40 ans plus tard. Elle ne fonctionnait pas si bien à l’époque mais trouve tout son sens maintenant. On peut supposer que le jeune Perrett avait vu l’avenir dans un flash. Il savait que tout cela arriverait. Il avait vu l’abîme et la lumière. Il avait vu la vérité et la fin des temps. On peut dire ce que l’on veut mais ces types-là auront toujours une vie d’avance sur nous. C’est pour cela qu’il faut leur baiser les pieds. Ils ont vu plus loin et c’est pour cela qu’ils n’ont pas bougé.
Ca recommence et c’est déjà fini. C’est celui qui le dit qui est mort. On se souviendra de Peter et Zena comme de Syd et Nancy, comme de Burton et Taylor, pour le meilleur et pour le pire. Ce concert était une parenthèse enchantée.)
Il n’y a rien en dehors.
Photos : Benjamin Berton.