 S’il fallait trouver un modèle récent de bande originale réussie, celle de Rone pourrait y concourir. N’allons pas par quatre chemins : cet album est magistral, et élève le film vers les hauteurs. Reparti avec le prix Cannes Soundtrack sous le bras, cette bande-son est peut-être, avec ses images, ce qu’il y a de plus beau dans le film de Jacques Audiard, certes mineur, mais marquant un tournant revigorant.
S’il fallait trouver un modèle récent de bande originale réussie, celle de Rone pourrait y concourir. N’allons pas par quatre chemins : cet album est magistral, et élève le film vers les hauteurs. Reparti avec le prix Cannes Soundtrack sous le bras, cette bande-son est peut-être, avec ses images, ce qu’il y a de plus beau dans le film de Jacques Audiard, certes mineur, mais marquant un tournant revigorant.
Amusant est de savoir qu’Audiard avait choisi la musique de Schubert pour revêtir provisoirement les maquettes présentées à Erwan Castex (Rone). Nous saluons ce revirement, car le classique aurait conféré une toute autre couleur à ce film ; plus grave, moins supportable. Tourné presque exclusivement en noir et blanc, Les Olympiades dépeint l’humble histoire d’un carré amoureux qui se cherche. Une sorte de Rohmer précaire, à l’heure post-digitale, un portrait dégrisé de vingtenaires et trentenaires déboussolés comme seule une époque creuse l’autorise. Plus intéressant encore est de voir qu’Audiard, s’inscrivant auparavant dans un certain classicisme du cinéma français, vire de bord (alors que son dernier long était Les Frères Sisters, western tourné en langue anglaise avec Joaquin Phoenix), sans nul doute grâce à la modestie du projet initial.
Love Me Tinder
Fini les films sociaux avec ses archétypes, souvent idéalisés, que seul un bourgeois peut se faire d’une classe qu’il ne connait qu’à travers la littérature et le cinéma, ou qu’il peut frôler le temps de quelques mois de tournage, légers travers avec lesquels Audiard pouvait en énerver certains (pas à chaque film, mais tout de même), comme De rouille et d’os. Ou ses fins tirant vers un romanesque naïf (quoique ce film n’y échappe pas non plus), refusant le tragique de la fatalité sociale. Les Olympiades ne se veut pas un film social ; mais d’un social onirique. Un instantané dur et lucide, presque un prélèvement hasardeux de ce qu’est la jeune classe moyenne contemporaine. Mais sous-tendu par un virage onirique, tout comme un Woody Allen s’essaye, depuis seulement Minuit à Paris, soit une décennie seulement, à l’esthétisme. Le noir et blanc n’annule pas, mais anesthésie la tristesse des barres du 13ème arrondissement, du bitume froid, pauvre, triste. Une autre preuve, meilleure encore, est cette bande-son verticale, contraposée des images. Elle est la palette de couleurs manquantes.
Si vous rencontrez un jour un de ces musicophiles sceptiques envers l’électro et sa capacité poétique, Call Center l’en dissuadera. Magique, élégiaque, c’est une musique qui élève. Quelques courtes minutes – comme toutes les autres – suffisent à offrir au film le lyrisme qu’il se devait d’avoir. Rone élève ici le réalisme pour mieux le border d’un lac de poésie. La voix angélique, déployées sous diverses notes, euphorisantes, nous fait jubiler vers le ciel. Exactement la sensation qui étreint les personnages (et nous de même) quand une nouvelle galvanisante se profile, qu’une opportunité proche de rosir votre quotidien se dessine. Emilie Dance est du même acabit, étourdissante, ensorcelante. Rone a l’audace même d’assaisonner celle-ci d’une pincée de trance, ayant probablement fait appel aux souvenirs juvéniles que le compositeur en devenir éprouvait face à l’ouverture d’un festival Armada ou un concert d’Eric Prydz. Un peu d’electronica lo-fi s’immisce dans One month Later, tendance retrogaming, tout comme se glissent, à travers l’Opening, quelques accords EDM ou trap. Celui-ci draine l’énergie grouillante du quartier parisien, espace mixte, intérieur et extérieur à Paris, point de rencontre des multiples solitudes. Nous voici bien loin de Schubert. Et pourtant, la force lyrique est bien là…
D’ailleurs, la musique classique n’est pas bien éloignée, les instruments traditionnels n’étant pas en reste. End Love incorpore ce que l’on penserait être des réminiscences de Haendel ou des gammes de Bach, alors que le piano hésitant de Camille & Emilie témoigne, comme un message adressée à l’une de ses héroïnes, qu’un redressement à la mollesse du monde est possible. La bande-son de Rone veut emmener son auditeur vers quelque chose d’impérialement grand et inconnu, bien au-delà des tours Prélude et Italie. Car sous son apparente simplicité, le film met à jour un sujet sociétal grave (peut-être le sujet, au fond, le plus important), générationnel : les milléniaux sont des impuissants de l’amour, des êtres en carence affective résultant d’une société asséchée, des métropolitains pensant avoir tout vécu alors qu’il n’en est rien. Qui se contentent de subir une existence au rabais, fragiles, si imbus d’eux-même qu’ils sont bien incapables de voir qu’ils souffrent du venin qu’ils sécrètent. Comment en sommes-nous arriver là? Audiard se garde d’y répondre, mais dépeint ce qui est : une jeunesse en décrépitude, d’une infinie solitude, pathétiquement nihiliste, enfermée dans une société en silo rendant tout dépassement inextricable. Dès lors, la musique de Rone se devait d’être supérieure, là pour désaltérer. Le lit devient ainsi un refuge, précieux et dernier îlot de soulagement. Paris 13th est accompagné du violoncelliste Gaspar Claus, et le morceau est tout bonnement merveilleux, un assemblage amélioré de Sophora Japonica, Twenty 20 et L’orage, délestés des vocaux inutiles de Laura Etchegoyen et de Roya Arab (albums Room With A View et Rone & Friends). Les doux pianotements de chats rappelleront ce que toute personne peut ressentir après un acte sexuel, lorsqu’elle découvre, le matin arrivé, alors que l’hôte sommeille encore, la découverte d’un appartement inconnu, la rencontre d’une intimité étrangère.
Les grandes solitudes
Une véritable douceur traverse la musique de Rone. Elle ne fait que dénoter avec la nudité des images, accompagnant les rares mouvements d’alacrité. Sister, renoue tendrement l’entre-aide entre la jeune Émilie et sa sœur ainée, et Rone interpelle le spectre de l’enfance, avec des sonorités évoquant les berceuses, tout comme l’inoffensif, l’allègre Arrival, qui n’est pas sans rappeler la candeur de certaines pistes de Cliff Martinez pour The Neon Demon. Même une piste comme MDMA, malgré son nom, est empli d’un optimisme sauvageon, qui n’est pas sans rappeler M83 ou Para One. Bizarre… Ce qui est mis devant nos yeux est gravement laid, ou, tout du moins, banal. Même les nombreuses scènes de chassé-croisé sexuel n’ont aucune grâce, si ce n’est celle d’être… normale, la beauté de l’ordinaire, comme seule la vie nous offre l’occasion de la voir. Étant donné la pudeur reconnue de Jacques Audiard, nous voilà plus qu’agréablement étonné. La scénariste et réalisatrice Céline Sciamma (Portrait de la jeune fille en feu, Tomboy) y serait-elle pour quelque chose? Probablement. Et pas que dans les images. Connue pour accompagner ses propres films de son ami Para One à la bande-son, camarade de la Fémis, compositeur et figure DJ de la scène french touch des années 2000 (il vient de sortir son premier métrage, Spectre : Sanity, Madness and The Family), aucun doute sur le fait que le pied-à-terre qu’elle a sur cette scène ait joué sur l’arrivée de Rone, dont la musique partage quelques connivences avec Para One. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien s’y on y voit lors de plusieurs scènes de fêtes du film le copain Teki Latex, DJ et rappeur du groupe TTC… et que l’on y entend quelques unes de leurs pistes en fond sonore.
Presque irrationnellement optimiste, la bande-son se veut une aspiration verticale, un remède à une mélancolie devenue banale. Pourtant, elle n’échappe pas à l’ombre du tragique. Mother relate la difficulté de vivre, l’angoisse d’une existence n’ayant pas tenu ses promesses. L’étonnant Porno, lui, est intrusif, répétitif, d’une sourde perfidie. Tout comme Paris 13th évoqué précédemment, il se cache chez Humiliation quelque chose de fallacieux, une tension du réel qui monte monte monte, comme un brutal réveil à l’ordre. La musique de Rone ne se pose pas seulement en complément, mais aussi en tremplin entre la maussaderie du présent et l’élan lyrique vers ses Olympiades qui portent si bien leur nom. Un quartier dont il connaît à présent bien les contours, puisqu’il avait signé la B.O. de La Nuit Venue, thriller qui s’y déroulait, et pour lequel il avait été césarisé. Looks n’est pas sans évoquer les nappes lumineuses de Brian Eno et le travail de John Murphy sur Sunshine de Danny Boyle. D’ailleurs, il s’agit d’une version retravaillée du merveilleux Solastalgia (album Room with a View). La bande originale est à l’image de Nora et son personnage, ailée, délicate, gracile, avec des sonorités souterraines filantes comme un courent d’air. C’est la musique des corps qui se cognent et de cœurs qui s’écorchent. Une musique épurée, à la fois allongée et élancée, en paix avec elle-même. Si l’on veut chercher des défauts à cette B.O., on pourrait dire qu’il arrive à Rone de retomber dans les même truismes, ces sonorités aériennes qu’il aime à user depuis quelques albums. D’ailleurs, ces derniers contenaient presque les ingrédients, si ce n’est la recette de cette bande-son (les morceaux Et le jour commence avec la chanteuse Jehnny Beth, qui joue un des protagonistes principaux, Breathe In annonçait Looks, Un, Sot-l’y-laisse, etc.). Ne chipotons plus. C’est ce genre de bande-son qui nous redonne foi en l’avenir. Cette B.O. est remarquable, presque autant que celles réalisées par Scratch Massive, notamment pour le récent documentaire Préliminaires, pas tant éloigné dans sa problématique. Outre les majestueux mouvements de caméra, dont le noir et blanc transcende la brumaille du quartier chinois, Rone est sans doute l’acteur principal embellissant ce film.










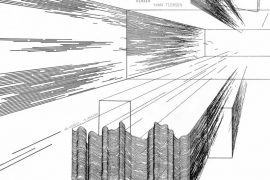


Je ne vais pas détailler, mais je ne suis pas tout à fait d’accord avec l’analyse du film. Pour moi, Audiard fait du cinéma avant de faire de l’analyse sociologique et c’est ce qui fait son importance. À une époque où le consommateur/spectateur exige des explications sur le monde (une tendance qui montre à quel point il est perdu puisque les artistes n’ont pas les réponses sinon ils feraient de la politique), Audiard reprend les thèmes du cinéma classique – des thèmes qui remontent jusqu’à la mythologie et qui dépassent les époques et les luttes politiques contemporaines.
Et, au final, la musique de Rone m’a quelque peu gênée pendant le visionnage du film. Parce que ce n’est pas le son électronique que je préfère et qu’on la remarquait trop facilement. Un peu comme les envolées symphoniques dans un Spielberg, ça m’a agacé probablement parce que j’espèrais autre chose de manière inconsciente. En tous les cas, je ne suis pas sorti de la salle en me disant « Waouw, il faut absolument que je réécoute cette bande son ».
Par contre, autant les fins de ses films me satisfont plutôt, autant j’ai ressenti un optimisme un peu forcé sur celle-là. Peut-être parce que je suis d’une génération où l’on chantait « Les histoires d’amour finissent mal en général » (bon, trente ans de mariage de mon côté).
Concernant l’analyse, je ne pense pas me tromper : son entretien à France Inter (On aura tout vu – 30/10/21) corrobore avec ce que j’avance. Peut-être que j’y vais un peu fort avec des grands mots (à vrai dire, je n’étais pas né lors de votre mariage, je suis témoin de cette génération, et il y a beaucoup à redire), certes. Mais force est de constater que le film n’est pas tendre avec cette « jeunesse » qui croupit (l’ennui, les scènes en amphi ou en boîte, le harcèlement, les abandons successifs, etc.). Ils sont individualistes, et incapables de s’engager, alors qu’au fond… ils ont un petit cœur qui bat!
Et d’ailleurs, nous sommes d’accord : Audiard donne à voir, sans pour autant expliquer. Le spectateur constate. L’histoire de ces 4 jeunes adultes, un carré amoureux comme il y en a toujours eu, préexiste à toute analyse sociologique (on est pas devant un Ken Loach). D’ailleurs, le scénario est adapté d’un comics d’Adrian Tomine.
Le N&B et la musique est tout le contraire de ce qui est montré, banal : pas pour rien qu’ils soient éthérés et aériens. Alors oui, la B.O. est bien mise en valeur, mais moins, je trouve, qu’un John Williams partant en fanfare chez Spielberg. Les B.O. électroniques sont moins prégnantes que les orchestrales.
Je suis là encore d’accord : la fin est assez ratée, mais c’était à s’y attendre avec cette B.O. (au fond, cela devait « bien » se terminer). Pour moi, ce n’est pas le problème, mais cela aurait dû être moins emphatique et vite expédiée. Comme « De Rouille et d’Os » d’ailleurs.Audiard est presque septuagénaire, oui, c’est sans doute générationnel. Il est né optimiste. À mon avis, il surestime un peu les milleniaux. Si cela le rassure…