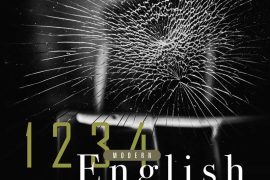Rater sa vie est chose facile ; la rater avec virtuosité est moins aisé. Beth Orton se glisse à nos oreilles comme un rappel. Pour elle, les dernières années ont été compliquées : le label Anti- l’a éconduite après proposition de la maquette de ce que nous avons sous les oreilles, et cela en plein confinement. Depuis, Orton a trouvé domicile chez Partisan Records. C’est donc la gorge nouée que la chanteuse britannique propose au monde Weather Alive, huitième album solo, jouant le tout pour le tout avant de – peut-être – fermer les rideaux à jamais.
Les moissons du cœur
On en avait eu écho cet été. Le titre éponyme nous promettait un album ouaté mais grave. Eh bien oui, c’est exactement ce que nous avons. Weather Alive est touchante et fragile, comme si cette musique ne tenait qu’à une toile d’araignée. Le xylophone imite une goute faisant son chemin entre les feuilles, avant de se glisser sur une joue : c’est à croire qu’on entend Orton pleurer. C’est une balade pastorale d’une mélancolie terrible, si émouvante que l’on en sort presque gêné. Cet album est d’une fragilité descente et incandescente, rongée par un doute et une pudeur nobles. La vulnérabilité d’Orton est supportable, car au fond, nous ne pouvons la croire ; nous savons qu’elle a tort à son sujet. Sa voix a la chaleur d’une Annette Peacock sylvestre. Sa musique, elle, prend un tournant autre, similaire à la dernière ligne droite de Talk Talk (la période Spirit of Eden), plus minérale et touffue, sans pour autant être confuse.
On a comme l’impression de se balader dans une nature sur le point de s’éveiller. Friday Night, dans une veine similaire à Weather Alive, rappelle musicalement le début apaisée du Belfast Child des Simple Minds (on peut en dire autant du With or Without You de U2, et pourtant, on pense particulièrement à Simple Minds) ou divers morceaux de The Blue Nile. On a pas trouvé plus étonnant à dire, tant les morceaux n’ont en rien la même fermeté. Et pourtant, leur force et leurs relents sont ceux d’invoquer tout un folklore britannique, ses créatures invisibles se cachant derrière les cairns ; le pouvoir des pierres et ce doux tourment des âmes. On beigne dans un cocon de chaleur au travers ce rayon de soleil automnal, comme un oisillon solitaire ou un crustacé se protégeant dans une conque dorlotante. Comme les balades champêtres matinales, l’album en appelle à nos souvenirs à l’heure des comptes.
Piano aqueux
L’ambiance éthérée change un peu ensuite. On se plonge dans l’étude des Fractals, morceau venant égailler la chose. Beth s’essaye au laisser-aller, et les instruments la suivent. Nous, on bûche et tombons dans une spirale jazzy. C’est con, mais on croirait presque qu’elle avait écouté Sympathy for The Devil des Rolling Stones juste avant de peindre son arrière-fond sonore. Dire cela ne vous aidera en rien à dresser une digue entre les groupes, mais vous voilà prévenus. Les morceaux suivants renouent avec un trip hop panthéiste et un ambiant organique, quelque part peut-être entre les groupes Bent, Télépopmusik et Saint Étienne. Encore ici, nous n’excluons pas d’avoir tort. L’accord de piano de Forever Young est entêtant comme un regret, de ceux qui nous attrapent le cœur à mi-chemin de sa vie. C’est comme revenir dans le parc de l’enfance pour s’y balader, et constater que rien n’a vraiment changer : la vie n’a pas été toujours à la hauteur de nos espoirs. Sur Haunted Satellite, les maracas donnent du moelleux au sable d’hiver tout en sautillant dans un coin de tête. L’épaisseur musicale est belle, et les éléments minéraux se matérialisent par les notes : le vent s’incarne dans le souffle de Beth, les gouttes dans le pétillant des notes, le temps file au galop. Leur puissance émotionnelle est une ondée de grâce, et Orton apparait en peintre isolée des sons.
Jamais Orton n’a été aussi solitaire (et donc, aussi libre) que sur cet album. Nous évoquions instrumentalement Simple Minds et The Rolling Stones tout à l’heure. L’âme de l’album, elle, est plus du côté de la folktronica, et donc du folk, mais, contrairement à celui du Nebraska de Bruce Springsteen et d’autres, c’est un folk enrichi en oméga : mouillé, ruisselant. Lonely dans son coin, Beth porte son mal-être comme un gant. Comme l’admiré Leonard Cohen, sa voix est puissamment puissante, se démarquant d’un arrière-son douillet, celui d’une mélancolie éclairée par un feu de cheminée, un dimanche de brumaille sans enfant. Pourtant, cela ne l’a empêché de débaucher les copains Tom Skinner et Tom Herbert, respectivement batteur de The Smile et bassiste de The Invisible, pour grossir l’orchestre, mais aussi le saxophoniste Alabaster dePlume et multi-instrumentiste Shazad Ismaily, tout en se rappelant du spectre du camarade Andrew Weatherall. L’orchestre est excellent, mais ne cherchez pas plus loin ; tout se joue ici dans son piano gourmand. L’album entier s’enroule autour.
On pourra regretter un album ne se dispersant jamais assez (Weather Alive et Friday Night, deux titres se ressemblant dans leur tristesse commune, se suivent à la queue), ficelé autour d’un motif du piano peut-être trop récurrent et répété. Arms Around a Memory est probablement, avec l’éponyme, le plus beau des titres. Il y a ce quelque chose d’irrattrapable, de terrible, quand un état des lieux de l’existence s’impose. Face à ce sentiment de vertige soulèvant le cœur, on se laisse enlacer par Beth dans cet équitable partage des peines. Unwritten parachève le constat d’ensemble. Orton nous console pour une dernière étreinte sous un plaid. Elle apparait alors comme une mère feuillage, un éternel féminin enlacé dans le minéral et dont on entendrait la musique après l’avènement du silence. C’est en dépouillant ses oripeaux et en écartant les injonctions de toute une carrière que Beth Orton atteint une épure libérée.